
Derrière l'étiquette, l'humain : portrait de Daliya Akter, ouvrière textile au Bangladesh
Au Bangladesh, environ quatre millions d’ouvrier.e.s s sont employé.e.s à bas coût dans quelque 4.500 ateliers de textile : plus de 80% sont des femmes. A l’occasion de l’avant-première du film “Made in Bangladesh” organisée par Dream Act en 2019, nous avions rencontré l’une de ces ouvrières textiles dont la vie a inspiré la fiction de Rubaiyat Hossain, la réalisatrice. Portrait.
 Daliya Akter - Crédit photo :© Konbini News
Daliya Akter - Crédit photo :© Konbini News
Fuir un mariage forcé
Daliya Akter naît un 26 décembre 1993 dans la région de Bari Sall, au sud du Bangladesh dans une famille bengali traditionnelle : sa mère s’occupe du foyer quand son père enchaîne les petits boulots, de la menuiserie à l’agriculture. Daliya va à l’école et aide sa mère à la maison pour s’occuper de ses 4 frères et sœurs. Son destin bascule une première fois à l’âge de 11 ans, quand son père, à court de ressources, annonce lui organiser un mariage avec un cousin de 30 ans son aîné. Daliya refuse de répéter le schéma malheureux de sa famille - sa mère ayant été mariée de force à 10 ans et sa grand-mère, à 7 ans. “ J'avais 12 ans et je voulais continuer à étudier. Mon rêve était de devenir policière, d'aider mon pays, mon père, ma famille et de m'en sortir… Si j'étais restée parmi eux, j'aurais été contrainte de me marier et aurais été maman de 8 ou 9 enfants.”
À l’aide d’un couple d’amis, elle s’enfuit vers la capitale : Dacca. Elle y fait des ménages chez les voisins et trouve un travail dans une usine de chaussures : “Nous étions nombreux à n’avoir que 12, 13, 14 ans. Le manager ordonnait aux mineures de se cacher dans les toilettes quand les inspecteurs publics visitaient l’usine”
Dans son village d’origine, ses parents sont dans la misère et l’embarras, Daliya étant accusée d’avoir fui pour un garçon. L’enfant survit et économise tant qu’elle peut, mais se brouille avec sa patronne et tombe malade “en raison des conditions de travail déplorables et des produits toxiques". Elle retourne à 13 ans chez ses parents pour être soignée et découvre la précarité encore plus terrible dans laquelle ils se trouvent.
Retour à l'usine et début de l'enfer

Crédit photo : DR / Pyramides film - les films de l'après-midi
Daliya revient à Dacca pour s’émanciper enfin en 2012. Elle a 19 ans et obtient un premier emploi dans l’industrie textile : elle doit marcher une heure par jour pour rejoindre le lieu où elle travaillera durant 12 heures, chaque jour de la semaine, pour 5€ par mois. “Au début, je ne savais pas utiliser la machine à coudre. On cousait des parties de vêtements. On était traités comme du bétail. Je ne posais pas de questions, je subissais.” A l'époque, Daliya ne sait pas que les vêtements qu'elle coud sont à destination de l'étranger, et qu'ils y sont vendus à des prix exhorbitant, comparé à son salaire.
Elle change d’entreprise un an plus tard et double son salaire en variant les postes. En 2006, une loi passe enfin au Bangladesh pour réglementer le salaire minimal des ouvrier.e.s, qui passe à 25€ par mois. La jeune femme s’épuise chaque jour à la tâche dans des conditions désastreuses, jusqu’au jour où elle apprend que le fruit de son travail extrêmement difficile est vendu très cher en Occident.
Cette injustice profonde devient un moteur. Elle discute alors avec ses camarades à propos de leur salaire indécent et de leurs congés inexistant. Elle contacte une association qui lui fait prendre conscience de ses droits fondamentaux au travail, et décide de tout faire pour créer un syndicat dans son usine. “ Je ne connaissais même pas le terme “droits”. Avec cette association j’ai découvert les lois et appris à parler devant les directeurs d’usine. ” ” Elle convainc ses amies de soutenir son action et lance une pétition pour l’ouverture d’une section syndicale.
Mise en lutte
 Image tirée du film Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain
Image tirée du film Made in Bangladesh, de Rubaiyat Hossain
Une véritable bataille commence : Daliya et ses amies sont méprisées et menacées, d’abord par leur patron...puis par leur propre entourage. « Le manageur a appelé plusieurs fois des membres de ma famille. D’abord, mon père, qui, avec ma mère, m’a demandé de sortir de là. Puis mon mari, à qui le manageur a proposé un pot-de-vin, en lui disant que je n’avais plus besoin de travailler ».
Daliya ne cède pas et se rend trois fois par semaine au ministère du travail, où elle n’est pas entendue par les bureaucrates. En désespoir de cause et profondément éprouvée, elle finit par menacer un fonctionnaire de se pendre dans son bureau s’il n’autorisait pas le syndicat. Elle tient le coup en s'inspirant de Sheikh Mujibur Rahman, symbole de la liberté pour la jeune bengali, qu'elle écoutait déjà enfant. Après des mois d’acharnement, elle obtient enfin gain de cause.
La jeune femme ne s’arrête pas là et continue de militer pendant 3 ans pour des conditions meilleures en manifestant notamment devant le siège des médias locaux pour convier les journalistes. Sa plus grande fierté ? « Le jour où j’ai annoncé à mes camarades tout ce que nous avions obtenu : une prime après 30 jours de travail consécutifs, une crèche, le congé maternité… J’étais tellement émue. Je les regardais sourire, heureux. Je me suis dit que tout le malheur, les souffrances, les violences que j’avais connues dans ma vie s’effaçaient.»
De l'histoire au cinéma
C’est lors de ces actions qu’elle entend parler de Rubaiyat Hossain, cinéaste bengali féministe qui souhaitait faire la lumière sur les ouvrières textiles dans son pays. Elles se rencontrent et Rubaiyat s’inspire de l’histoire de de Daliya pour réaliser le film “Made in Bangladesh” qui raconte.... le quotidien de Shimu, ouvrière de 23 ans qui va se battre contre son patron, le ministère et son propre mari pour monter un syndicat dans son entreprise.
En 2019, au moment de la promotion et diffusion du film dont Dream Act a organisé l’avant-première, Daliya ne travaille plus au Bangladesh. Son usine de Dacca ayant fermé et venant de divorcer, la jeune femme est partie avec sa fille en Jordanie pour y travailler. Lorsqu’elle a demandé à son employeur des congés, cela lui a été refusé : elle a donc démissionné pour venir raconter son histoire partout en Europe. Lorsque nous l'avions rencontré, elle projetait de retourner au Bangladesh : “J’ai espoir de travailler pour une ONG et de continuer à me battre pour défendre les droits des ouvrières et porter leur voix.”
 Daliya Akter (à g.) et Rubaiyat Hossain (à d.), cinéaste bengali
Daliya Akter (à g.) et Rubaiyat Hossain (à d.), cinéaste bengali
Crédit photo :© Ed Alcock M.Y.O.P. 20/11/2019
Quelle est la situation du Bangladesh aujourd’hui ?
Après les grèves de 2018 et 2019, le salaire mensuel a été augmenté à 82€ par mois ce qui n’est pas suffisant comparé au coût de la vie locale. Ce pays est le 2e producteur mondial (après la Chine) et toute son économie repose sur l’industrie textile : lors de la crise du Covid-19, les grandes marques européennes de prêt-à-porter ont repoussé ou annulé 3,1 milliards de dollars de commandes déjà passées auprès de leurs fournisseurs bangladais. Plus d'1 million d'employé.e.s ont été licencié.e.s du jour au lendemain sans être payé.e.s. Concrètement, la collection printemps-été 2020 de nombreuses marques de fast-fashion aura été fabriquée par des hommes et des femmes qui n’ont pas été payées pour ce travail et ont finis à la rue.
La preuve que les marques conventionnelles se fichent des conditions de vie et de travail de leurs ouvrier.e.s. Si le boycott n’est pas une solution durable, la déconsommation et la co-construction d’une économie mondiale juste et équitable sur toute la chaîne le sont...
Ces mêmes marques continuent la guerre des prix : si les coûts et délais ne sont pas assez bas pour eux, ils changent de pays (Viêtnam et Ethiopie en ce moment selon le CGWR, centre pour le droit des travailleurs). En effet, l’efficacité des modèles des industries de la fast-fashion repose sur une guerre des prix et une main d’œuvre sous-payée, qui permet de générer des profits colossaux pour l’enseigne. D’après le collectif Éthique sur l’Étiquette, la marque ZARA capte par exemple 90% des bénéfices générés sur toute la chaîne de valeur.

Article rédigé par :
Cécile P.
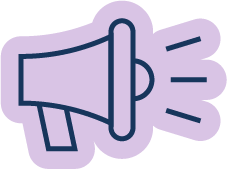


Les avis de la communauté
Aucun commentaire pour le moment
Donnez votre avis